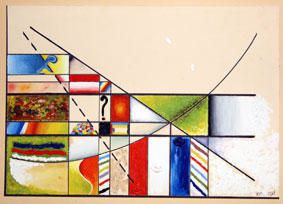[32] Ibid. p. 35.
Bibliographie
ABRAHAMSON E., HAMBRICK D.C. [1997], "Attentional Homogeneity in Industries: The Effect of Discretion", Journal of Organizational Behavior, vol. 18, pp. 513-532.
ALCHIAN A.A. [1950], "Uncertainty, Evolution, and Economic Theory", Journal of Political Economy, vol.58, n°3, June, pp.211-222.
ARENA R., FESTRE A. [2002], "Connaissance et croyances en économie : l'exemple de la tradition autrichienne", Revue d'Économie Politique, vol. 112, n°5, pp. 635-657.
ARGYRIS C., SCHÖN D.A. [1978], Organizational Learning: A Theory of Action Perspective, Addison-Wesley.
ARROW K.J. [1986], "Rationality of Self and Others in an Economic System", Journal of Business, vol. 59, n°4, pp.385-399.
AXELROD Robert [1976], Structure of the Decision: the Cognitive Maps of Political Elites, Princeton University Press.
BROWNLIE D., SPENDER J.C. [1995], "Managerial Judgement in Strategic Marketing. Some Preliminary Thoughts", Management Decisions, vol. 33, n°6, pp. 39-50.
CALORI R., JOHNSON G, SARNIN P. [1994], "CEO's Cognitive Maps and the Scope of the Organization", Strategic Mapping Journal, vol. 15, pp. 437 457.
Carluer-Loussouam F., Dauvers O. [2004], La Saga du commerce français, Éditions Dauvers.
CARMELI A., SCHAUBROECK J. [2006], "Top Management Team Behavior, Decision Quality, and Organizational Decline", The Leadership Quarterly, vol. 17, n° 5, pp. 441-453.
CHATRIOT A., CHESSEL M.-E. [2006], "L'histoire de la distribution : un chantier inachevé", Histoire, Économie et Société, vol. 25, pp. 67-82.
CHILD J. [1972], "Organization Structure, Environment, and Performance: The Role of Strategic Choice", Sociology, vol. 6, pp. 1-22.
COHEN W., LEVINTHAL D. [1990], “Absorptive capacity : a new learning perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, vol.35.
CYERT R.M., MARCH J.G. [1963], A Behavioral Theory of the Firm, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York.
DAUVERS O. [2003], "Bob le hardeur, assassiné pour avoir bloqué la roue de la distribution", in Le commerce en 2053, IFM, Paris, pp. 12-16.
DEEPHOUSE D.L. [1996], "Does Isomorphism Legitimate?", Academy of Management Journal, vol. 39, n°4, pp. 1024-1039.
gb" xml:lang="en-gb">DEEPHOUSE D.L. [1999], "To Be Different, or To Be the Same? It's a Question (and Theory) of Strategic Balance", Strategic Management Journal, vol. 20, pp. 147-166.
DiMAGGIO P.J., POWELL W.W. [1983], “The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American Sociological Review, vol. 48, pp. 147-160.
DUNCAN R.B. [1972], Characteristics of Organizational Environments and Perceived Environmental Uncertainty", Administrative Science Quarterly, vol. 17, pp. 313-327.
EDEN C. [1988], "Cognitive Mapping", European Journal of Operational Research, vol. 36, n°1, pp.1- 13.
EHLINGER S. [1996], "Interaction et développement de représentations organisationnelles lors du processus de formation de la stratégie au sein d’organisations multidivisionnelles", Thèse de doctorat, Université Paris-Dauphine.
Festinger L. [1957], A theory of Cognitive Dissonance, CA, Stanford University Press.
GELETKANYCZ M.A. [1997], "The Salience of "Culture's Consequences": The Effects of Cultural Values on Top Executive Commitment to the Status Quo", Strategic Management Journal, vol. 18, n° 8, pp. 615-634.
GELETKANYCZ M.A., BLACK S.S. [2001], “Bound by the Past ? Experience- Based Effects on Commitment to the Strategic Status Quo”, Journal of Management, vol. 27, n°1, pp. 3-21.
GEORGESCU-ROEGEN N. [1954], “Choice, Expectations and Measurability”, The Quarterly Journal of Economics, vol.67, pp.503-534.
GRANOVETTER O. [1985], "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness", American Journal of Sociology, vol. 91, n°3, pp. 481-510.
GUPTA A., GOVINDARAJAN V. [1984], “Business Unit Strategy, Managerial Characteristics, and Business Unit Effectiveness at Strategy Implementation”, Academy of Management Journal, vol. 27, pp. 25-41.
HAMBRICK D.C., GELETKANYCZ M.A., FREDRICKSON J.W. [1993], "Executive Commitment to the statu quo: Some Tests of its Determinants", Strategic Management Journal, vol. 14, pp. 401-418.
HAMBRICK D.C., MASON P. [1984], "Upper Echelons: The Organization as a Reflection of its Top Managers", Academy of Management Review, vol. 9, pp. 193-206.
HAYEK F. [1953], Scientisme et sciences sociales, Plon, Paris.
HAYEK F.A. [1978], "The Primacy of the Abstract", in New Studies in Philosophy, Politics, Economics, and the History of Ideas, Routledge and Keagan Paul, London.
HUFF A. [1990], Mapping Strategic Thought, Wiley, New York.
HUFF A.S., HUFF J.O., with BARR P.S. [2000], When Firms Change Direction, Oxford University Press, Oxford.
JACQUEMIN A. [1985], Sélection et pouvoir dans la nouvelle économie industrielle, Economica-Cabay, Paris, Louvain-La-Neuve.
KIRZNER I.M. [1979], Perception, Opportunity, and Profit. Studies in the Theory of Entrepreneurship, The University of Chicago Press, Chicago & London.
KNIGHT F.H. [1921], Risk, Uncertainty and Profit, H. Schnaffer & Marx, New York.
LEVINTHAL D.A., MARCH J.G. [1993], "The Myopia of Learning", Strategic Management Journal, vol. 14, pp. 95-112.
McCABE D.L., DUTTON J.E. [1993], "Making Sense of the Environment: The Role of Perceived Effectiveness", Human Relations, vol. 46, n°3, pp. 623-643. McNair [1931, 1958].
MILLER D. [1991], "Stale in the Saddle: CEO Tenure and the Match between Organization and Environment", Management Science, vol. 37, pp. 34-52.
MOATI P. [1989], La filière sport, rapport pour le ministère de l’Industrie et le secrétariat d’Etat à la Jeunesse et aux Sports, CRÉDOC, Paris.
MOATI P. [1992], "La filière du roman : de la passion à la rationalité marchande", Cahiers de l'économie du livre, n°7, mars, pp.103-138.
MOATI P. [1996], "Méthode d'étude sectorielle", vol.2, Cahier de recherche CRÉDOC, n°93, sept.
MOATI P. [2001], L'avenir de la grande distribution, Odile Jacob, Paris.
NELSON R.R., WINTER S.G. [1982], An Evolutionary Theory of Economic Change, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Mass.
NYSTROM P.C., STARBUCK W.H. [1984], "To Avoid Organizational Crises, Unlearn", Organizational Dynamics, spring, pp.53-65.
PENROSE E. [1959], The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford.
PENROSE E. [1963], Facteurs, conditions et mécanismes de la croissance de la firme, Éditions Hommes et Techniques, Paris.
PERRIN J.C. [1993], “Décentralisation et milieux locaux : étude comparative”, in C. Dupuy et J.P. Gilly (eds), Industrie et territoires en France, La Documentation Française, Paris, pp.71-93.
PFEFFER J., SALANCIK G. [1978], The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York.
PIERCE J.L., BOERNER C.S., TEECE D.J. [2002], “Dynamic Capabilities, Competence and the Behavioral Theory of the Firm”, in M. Augier, J.G. March (eds), The Economics of Choice, Change and Organization. Essays in Memory of Richard M. Cyert”, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, pp. 81-95.
PORAC J.F., THOMAS H., BADEN-FULLER C. [1989], « Competitive groups as Cognitive Communities: The Case of Scottish Knitwear Manufacturers », Journal of Management Studies, vol. 26, pp.397-416.
PORTER M.E. [1982], Choix stratégiques et concurrence : techniques d'analyse des secteurs et de la concurrence dans l'industrie, Economica, Paris.
PRAHALAD C.K., BETTIS R.P. [1986], “The Dominant Logic: A New Linkage between Diversity and Performance”, Strategic Management Journal, vol. 7, pp. 485-501.
RALLET A. [2010], "Le commerce à l'ère de l'économie numérique : tendances et éléments de prospectives", in L'évolution du commerce à l'ère de l'économie numérique, Prospective et Entreprise, n° 11, février, Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, pp. 7-32.
Rumelhart D.E., Norman D.A. [1978], Accretion, tuning and restructuring: Three modes of learning. In JW Cotton & RL Klatzky (Eds), Semantic factors in cognition. Hillsdale,NJ Erlbaum.
SALAIS R., STORPER M. [1993], Les mondes de production. Enquête sur l’identité économique de la France, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris.
SALGADO, STARBUCK W.H., MEZIAS J.M. [2002], “The Accuracy of Managers’ Perceptions: A Dimension Missing from Theories about Firms”, in M. Augier, J.G. March (eds), The Economics of Choice, Change and Organization. Essays in Memory of Richard M. Cyert, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, pp. 168-185.
SANTOS-VIJANDE M.L., SANZO-PEREZ M.J., ALVAREZ6GONZALEZ L.I., VASQUEZ- CASIELLES R. [2005], "Organisational Learning and Market Orientation: Interface and Effects on Performance", Industrial Marketing Management, vol. 34, pp. 187- 202.
SCHEIN E. [1985], Organizational Culture and Leadership, Jossey Bass.
SIMON H.A. [1982], Models of Bounded Rationality, vol.2, The MIT Press, Cambridge.
SONG J.H. [1982], “Diversification Strategies and the Experience of Top Executives of Large Firms”, Strategic Management Journal, vol. 3, pp. 377- 380.
Sordet C. [1997], Les grandes voix du commerce, Liaisons Ed.
STEWART W.H., MAY R.C., KALIA A. [2008], "Environmental Perceptions and Scanning in the United States and India: Convergence in Entrepreneurial Information Seeking", Entrepreneurship Theory and Practice, Jan., pp. 83- 105.
STIGLER G. [1961], "The Economics of Information", Journal of Political Economics, vol.69, n°3, june, pp.213-225.
STORPER M. [1995], "La géographie des conventions : proximité territoriale, interdépendances hors marché et développement économique", in Rallet A., TORRE A. (eds), Économie industrielle et économie spatiale, Economica, Paris, pp.111-127.
SUTCLIFFE K.M., HUBER G.P. [1998], "Firm and Industry as Determinants of Executive Perceptions of the Environment", Strategic Management Journal, vol. 19, pp. 793-807.
TEECE D.J., PISANO G., SHUEN A. [1997], “Dynamic Capabilities and Strategic Management”, Strategic Management Journal, vol. 18, ° 7, pp. 509-533.
THIL E. [1966], Les inventeurs du commerce moderne. Des grands magasins aux bébés-requins, Arthaud, Paris.
WALSH J.P. [1995], "Managerial and Organizational Cognition: Notes from a Trip down Mamory Lane", Organization Science, vol. 6, n°3, pp. 280-321.