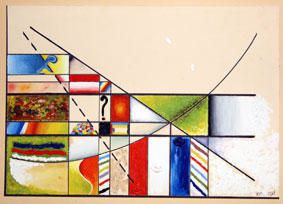Voici la transcription de la conférence que j'ai donnée le 16 février 2010 dans le cadre d'un "Atelier de la consommation" organisée par la DGCCRF sur le thème "Consommer, Conserver". J'y expose mes vues sur l''économie des effets utiles" que j'ai développées dans les articles accessibles en cliquant ici.
Bonjour à tous.
J’ai le privilège d’ouvrir le feu sur un sujet complexe. Je vais jouer, ainsi que Nicolas Herpin, le rôle de l’économiste et laisser de côté la dimension anthropologique du sujet qui sera traitée par mon voisin. De même, je ne fournirai pas de données sur les attitudes des consommateurs à l’égard de la problématique à l'ordre du jour, car à ma connaissance, les travaux du CREDOC n’ont pas abordé frontalement la question, sauf peut-être incidemment sur certaines enquêtes. Je vais plutôt vous livrer des réflexions qui se situent entre le sujet « conserver et consommer » et la réflexion que j’ai actuellement sur l’évolution des modèles de consommation dans la perspective de concilier croissance de la consommation et développement durable.
Comme cela a été dit en introduction, « consommer, conserver » paraissent deux termes en totale opposition, particulièrement dans le modèle de consommation que nous avons hérité du capitalisme industriel des Trente Glorieuses, qui marque encore très fortement la manière dont nous produisons et consommons. Ce modèle de consommation est totalement centré sur l’achat. D’ailleurs, au lieu de « consommer et conserver », nous aurions dû dire « acheter et conserver ». Nous avons d’ailleurs un spécialiste du marketing à cette table, il sera intéressant de l’entendre. Les ficelles du marketing ont pour principal objectif de stimuler l’envie d’acheter chez le consommateur. Ce qui se passe après l’achat est relativement secondaire à moins que cela ne conditionne un nouvel achat. À ce moment-là, il y a peut-être une force de rappel qui contraint à s’intéresser à la consommation, mais ce n’est pas du tout spontané. Ce modèle, centré sur la prospérité des entreprises, repose fondamentalement sur la quantité de produits vendus. Il faut donc faire du chiffre et du volume. Les consommateurs se doivent d’acheter des produits. Il serait très difficile d’imaginer une croissance économique sans achats au sens strict, une consommation sans achats, c’est-à-dire sans transferts de droit de propriété sur des objets. Peut-on imaginer une consommation sans achats, simplement fondée sur les usages ?
A l’inverse, « conserver » signifie que la pulsion d’achat serait tarie par le fait que le besoin est déjà satisfait par l’acquisition précédente. Il n’y aurait rien de pire dans le système actuel que des consommateurs qui conserveraient tout parce que leurs besoins seraient saturés et donc, la demande sur les marchés s’effondrerait. Nous sommes dans une sorte de machine infernale où il faut vendre sans arrêt des produits en nombre croissant si possible, ce qui sous-entend faire disparaître le stock de produits existants. Quelle est la stratégie pour faire disparaître ce stock ? Il y en a deux principales, la première étant de limiter la durée de vie physique du produit. Je ne suis pas un spécialiste, mais l’INSEE a dû faire des travaux sur la durabilité des produits. Il ne serait pas très difficile de concevoir des machines à laver, pour garder l’exemple qui a été pris, qui puissent durer vingt ans. On est capable de fabriquer des rames de TGV ou de métro qui durent cinquante ans, ce qui est j’imagine autrement plus compliqué. Mais, imaginez le marché de l’électroménager, qui n’est déjà pas très florissant, si les appareils devaient durer une vie ! De même pour l’automobile, ce serait catastrophique. On fait donc en sorte de concevoir les produits de façon à ce qu’ils ne durent pas trop longtemps. Ne parlons pas des téléphones portables, il me semble qu’ils sont conçus pour durer trois ou quatre ans. D fait on les mène rarement jusqu’à la fin physique de leur durée de vie. C’est la deuxième stratégie employée pour évincer les produits existants : on souffle sur les braises du désir pour rendre médiocre le produit qui était lui-même l’objet du désir auparavant, et qui devient détestable du fait qu’un autre a pris sa place dans le désir des consommateurs. Alors, comment réveille-t-on le désir et annule-t-on le potentiel de séduction du produit conservé ? Par la voie noble de l’innovation technologique. En effet, on va rajouter de nouvelles fonctionnalités dans la nouvelle génération de produits rendant « has been » la précédente. C’est très souvent un artifice car ces fonctionnalités nouvelles ne sont pas toujours très utiles. Moyen moins noble, on utilise la mode, tout simplement. On change l’aspect (forme, couleur…) en dénigrant la tendance précédente, et on rend ainsi obsolète artificiellement, et sur des laps de temps encore plus courts, les produits possédés pour susciter l’envie d’en acquérir d’autres.
Ce modèle-là a, bien entendu, eu des vertus. Il a été un moteur de croissance économique extraordinaire, un moteur de développement des technologies… Je ne critique pas l’acquis de ce modèle. Cependant, il est à bout de souffle et il est sans doute temps de réfléchir à de nouvelles choses. Pourquoi est-il à bout de souffle ? La raison majeure a déjà été exprimée, je ne la développerai pas, c’est l’aspect environnemental. Évidemment, « casser du produit » sans arrêt pour en produire d’autres, cela consomme des ressources, de l’énergie, etc. On sait qu’aujourd’hui ce n’est pas tenable. Il me semble que ce phénomène est suffisamment connu pour m’épargner d’avoir à développer ce point.
Un deuxième point me paraît important : l’idée selon laquelle les consommateurs vont jouer le jeu éternellement commence à montrer des signes de faiblesse. Les consommateurs pourraient commencer à entrer en résistance par rapport à ce modèle. D’une part, parce qu’ils pourraient être convaincus de l’enjeu écologique et des limites environnementales, et d’autre part, parce qu’il apparaît de plus en plus clairement, même en restant au cœur des valeurs de la société de consommation, que les promesses de ce modèle sont de moins en moins tenues. Combien de fois a-t-on été séduit par la publicité, jeté un produit existant pour en prendre un nouveau et regretté le temps et la somme d’argent investis ? Avec mes enfants, j’essaie de convertir tout objet en heures de travail, pour leur donner plus de consistance, et se demander si cela vaut la peine de travailler cinq, dix ou quinze heures pour changer son téléphone ou autre. C’est une comptabilité assez basique, mais qui je pense, commence à progresser dans l’esprit d’un nombre croissant de consommateurs. Je mets de côté les dix dernières années grâce à l’apport des NTIC, mais jusqu’à la fin des années 1990, le marketing n’ayant pas eu d’innovations majeures sous la main pour jouer la carte de l’innovation pour relancer le besoin, a surtout soufflé sur les braises de l’innovation marketing en quelque sorte, en jouant notamment sur la dimension immatérielle de la consommation - « ce produit va vous rendre plus beau, plus intelligent, plus séduisant, etc. » - et évidemment, il est difficile de tenir ses promesses quand elles se situent dans ce registre immatériel. Le côté déceptif de la consommation a été d’autant plus fort que la promesse portait sur des aspects touchant profondément l’individu alors qu’évidemment toutes ces promesses nécessitent bien d’autres choses que d’acquérir des objets pour pouvoir être satisfaites.
De même, on commence à voir des enquêtes réalisées par des économistes, des sociologues ou des psychologues qui montrent statistiquement que cumuler l’achat de produits ne rend pas plus heureux. Le résultat commence à être connu. J’ai découvert très récemment que, selon certains psychologues, les personnes les plus portées vers cette consommation frénétique (ce qu’ils appellent dans leur jargon des valeurs matérialistes), non seulement ne seraient pas plus heureuses, mais témoigneraient de davantage de pathologies que les personnes plus détachées de ces valeurs consuméristes alors que la société de consommation nous promettait l’épanouissement. Il est donc montré statistiquement que les consommateurs commencent à le ressentir. Quel est le rapport de cause à effet ? Est-ce la consommation qui rend malheureux, ou bien consomme-t-on lorsqu’on est malheureux, comme dérivatif ? En tout cas, le contrat n’est pas respecté.
Une fois qu’on a posé le débat en ces termes, si pour des raisons individuelles de responsabilité par rapport à l’environnement par exemple, ou bien parce que j’ai compris qu’on me pousse à vouloir consommer, à jeter et que cela ne fera pas mon bonheur, je veux changer mon comportement, moi, consommateur, que puis-je faire ? Peu de chose, à vrai dire. Je peux entretenir et réparer mes produits pour les faire durer plus longtemps, mais je me rends compte que cela coûte très cher car les produits non pas été conçus pour être réparés. Il est souvent plus coûteux de faire réparer que de changer. Je peux rester sourd aux sirènes de la tentation et faire comme Ulysse, me faire attacher au mât, ne pas regarder les publicités et ne pas aller dans les magasins. C’est ce que font les Français, d’ailleurs, en période de crise. Vous remarquerez que la fréquentation des centres commerciaux et des hypermarchés s’est réduite parce qu’ils exposent à la tentation. On peut effectivement tenter de résister, mais cela reste difficile, car la pression publicitaire n’a pas cessé d’augmenter. Je peux aussi recourir au marché de l’occasion. Si je veux changer, mais que j’ai mauvaise conscience de jeter, je peux donner à quelqu’un d’autre qui peut trouver intéressant d’acquérir ce produit, peut-être pas neuf, mais moins cher. D’une certaine façon, je rentre dans le jeu, mais je me donne bonne conscience en offrant une seconde vie au produit. Cette stratégie a l’air de plutôt bien fonctionner. Une enquête du CREDOC a révélé qu’en 2007, 27 % des consommateurs déclarent avoir déjà acheté un produit d’occasion. En 2009, nous sommes passés à 42 %. Donc, une très forte progression du recours au marché de l’occasion qui témoigne d’un dégoût du gaspillage. On peut l’interpréter d’une autre manière en disant qu’il s’agit d’une manière d’hyper-consommer encore plus alors que le pouvoir d’achat n’est pas à la hauteur. Je me débarrasse de ce dont je n’ai plus besoin afin de dégager des liquidités et pouvoir continuer à acheter avec intensité. Je vous laisse nourrir votre interprétation comme vous l’entendrez. En tout cas, à l’échelle de l’individu, on voit que les stratégies que l’on peut mettre en œuvre pour basculer du « consommer » vers le « conserver » sont très modestes. Si l’on considère qu’il est important d’aller un peu moins vers la consommation et plus vers la conservation, alors il faut changer le système économique. On ne pourra pas le faire uniquement en se fondant sur la bonne volonté. En premier lieu, je ne suis pas sûr que la bonne volonté soit un motif suffisant, et vous remarquerez surtout que ce qui est à notre portée en tant qu’individu est extrêmement limité.
J’essaie donc de réfléchir aux moyens d’arriver à rendre compatibles les aspirations du consommateur, sans parler du citoyen, partons de cette idée que dans la société française actuelle l’hyper-consommation et ses valeurs se portent bien, malgré le vernis de responsabilité - avec les aspirations légitimes des entreprises à vendre et à faire du profit, ce qui est le moteur de l’activité économique et n’est pas honteux, et d’autre part les impératifs du développement durable. Il semble que nous sommes confrontés à cette nécessité de trouver un compromis entre ces trois polarités qui, a priori, ont tout pour s’opposer.
L’idée très générale qu’il me semble intéressant de commencer à étayer, et qui d’ailleurs se diffuse autour de nous, car nous commençons peu à peu à nous éloigner du modèle de consommation hérité du capitalisme industriel, c’est l’idée de déplacer le lieu de la création de valeur et le lieu de l’échange, de la valeur d’échange à la valeur d’usage. Aujourd’hui les entreprises veulent produire de la valeur d’échange, c’est-à-dire qu’elles mobilisent des fonds pour produire et espèrent vendre ce qu’elles ont produit plus cher que ce que cela leur a coûté. Fondamentalement, la marchandise n’est que le support de la valeur d’échange, c’est-à-dire de la mise de fond qui a été faite au départ et du profit que cela crée. Afin de réaliser cette valeur d’échange, il faut évidemment évoquer une valeur d’usage. Pour que la valeur d’échange se réalise, il faut que des clients trouvent intéressante la proposition qui leur est faite. Mais, tout est fait pour susciter l’acte d’achat. Ce qui est important, c’est de réaliser la valeur d’échange et elle se réalise au moment de l’achat. On va donc envoyer des signaux sur la valeur d’usage, mais ce ne sont que des signaux pour séduire le consommateur. C’est cela qui mène aux abus décrits plus haut. Il serait pertinent de faire en sorte que la rentabilité des entreprises ne dépende plus uniquement de la valeur d’échange, mais directement de la valeur d’usage. Cela revient à déplacer le centre de gravité du modèle actuel du moment de l’achat, au moment de la consommation. C’est l’idée générale à laquelle il faut essayer de travailler.
En réalité, les entreprises avancent déjà dans cette direction, spontanément. Pourquoi ? Elles sont de plus en plus à l’écoute des attentes de la société, de leurs clients, mais aussi de la société dans son ensemble, à travers le registre de la responsabilité sociale des entreprises. C’est un thème qui progresse. Mais, encore une fois, nous sommes dans le domaine de la bonne volonté, alors je le mets de côté. Ce que j’observe surtout c’est, depuis une quinzaine d’années, la progression de la rhétorique sur l’orientation client. Le sésame de la compétitivité de l’entreprise d’un pays industrialisé, c’est d’être orienté client ou « customer centric » (mettre le sort du client au cœur), selon l’expression à la mode. Pourquoi cette prise de conscience de l’importance du client ? C’est la concurrence qui fait cela. Les marchés sont saturés, de plus en plus concurrentiels avec la mondialisation. On a pris conscience progressivement de la valeur que constituait un client. À l’époque des Trente Glorieuses, le client n’était pas un problème, le problème était d’arriver à produire à prix raisonnable. Une fois qu’on avait produit, les débouchés étaient quasiment automatiques. Aujourd’hui, le contexte étant beaucoup plus difficile, les clients ont de la valeur, et il faut tenter d’en faire un patrimoine. On réalise, dans ce mouvement de réflexion, l’importance de la satisfaction du client parce que, les études marketing l’ont montré, un client satisfait a plus de chance d’être un client fidèle. Or, comme il serait moins coûteux de fidéliser un client que d’en recruter un nouveau, la rentabilité de l’entreprise dépendra aussi de plus en plus de sa capacité à satisfaire ses clients. Pour cela, il faut comprendre la nature de leur demande, donc savoir pourquoi ils s’intéressent aux produits fabriqués par l’entreprise. Et lorsqu’on entre dans ce type de questionnement on réalise ‑ ce qui relève du bon sens ‑ que les clients ne demandent jamais un produit pour lui-même, mais afin qu’il leur soit utile, de quelque manière que ce soit. Si j’achète une machine à laver, ce n’est pas elle qui m’intéresse, mais le fait qu’elle lave le linge. Si j’achète un costume, j’achète en réalité quelque chose pour me protéger des intempéries, paraître devant vous selon les conventions sociales en vigueur, voire me faire plaisir. Dans les effets utiles, j’intègre ces effets liés à la dimension socio-psychologique de la consommation. Je ne reviens pas à une consommation utilitariste, ce n’est pas le propos. A la base de la demande d’un bien, il y a toujours l’attente d’effets utiles. Et plus généralement, il y a l’attente de la résolution d’un problème. Ce costume me permet de paraître devant vous aujourd’hui, j’avais donc un problème, paraître devant vous et ce costume a été un des éléments de la solution à ce problème.
Fondamentalement, c’est cela qui suscite la demande des consommateurs : des effets utiles associés au produit, comme solutions de problèmes de consommation. Si je comprends cela en tant qu’entreprise, j’arrête de parler de mes produits. Si je veux gagner en compétitivité, capter l’attention des consommateurs alors que l’offre est pléthorique, si je veux les satisfaire et les fidéliser, je cesse de parler de mes produits, comme on le fait depuis cinquante ans et je commence à parler des effets utiles que mon action va provoquer sur eux et de ma capacité à les aider à régler des problèmes de consommation en leur offrant des solutions plus ou moins intégrées. Voilà ce vers quoi vont progressivement les entreprises, certes très lentement, mais je crois que c’est tout à fait intéressant et que l’on devrait les pousser dans cette direction en forgeant un cadre institutionnel incitatif pour accélérer la marche en veillant à mettre en place un modèle de consommation vertueux sur le plan environnemental. L’intérêt de cela est que, lorsque l’objet de l’échange se déplace de la marchandise en soi, aux effets utiles ou aux solutions, on peut avoir un modèle de consommation qui assure de la croissance aux entreprises, une meilleure satisfaction des consommateurs, mais aussi l’économie de ressources au cœur du modèle. Voilà comment cela me semble possible.
Il y a deux niveaux de mise en place de ce nouveau modèle de satisfaction des besoins. Un, qui reste assez proche de ce que l’on connaît où l’on reste ancré sur le produit, mais où on le pense comme un vecteur d’effets utiles. Le deuxième niveau, plus ambitieux, consiste à mettre le produit de côté afin d’aller directement dans le registre de la solution.
Je vais commencer par le plus simple. Je reste dans une logique de produit. Mon activité en tant qu’entreprise est de vendre un produit, mais celui-ci n’est plus une fin en soi. À travers lui, je vise la production d’effets utiles pour les consommateurs. On peut même trouver des systèmes où le consommateur se mettra à conserver les produits sans pénaliser la rentabilité de l’entreprise. L’idée générale consiste à étendre la relation avec le client au-delà du moment de la transaction. En effet, dans un modèle général où vendre est l’objectif, tout est centré sur le moment précis de la transaction, lorsque l’on cède le droit de propriété et que l’on récupère l’argent. Si nous changeons de perspective en passant du produit aux effets utiles, il faut étendre la relation en amont et en aval de la transaction. En amont, c’est-à-dire aider le client à identifier le produit qui va lui offrir les effets utiles les plus pertinents en fonction de la nature de ses attentes. Car, acheter un produit qui, à l’usage, se révèle inadapté à son besoin spécifique est une source de déception. Le risque d’erreur dans l’achat est très courant, car au moment de l’achat, on ne dispose de nos jours que de très peu d’informations sur ses effets utiles. J’ai fait deux expériences, il y a peu de temps. L’une d’elle fut intéressante et l’autre calamiteuse. J’ai vécu l’expérience intéressante dans une enseigne de sport, chez Décathlon, où j’ai trouvé une fiche détaillée pour chaque article sur laquelle était expliqué pour quel type d’usage il était conçu. Bien que très sommaire (pas d’indication de bilan carbone, pas d’information concernant l’impact sur la santé ou de notion de durabilité du produit), j’avais une information. À l’inverse, dans une enseigne du même groupe, chez Leroy Merlin, je n’ai trouvé aucune information. Les produits dont les prix s’étalaient de 30 à 300 € étaient absolument identiques sur le plan de l’étiquetage. De manière générale, le consommateur aujourd’hui est toujours confronté à ce genre de problèmes. En achetant un produit, il ne sait pas ce qu’il achète. Il a au mieux une notice technique, mais qui renseigne mal sur les effets utiles qu’il est en droit d’attendre, notamment concernant la durée de vie du produit, et le coût d’usage. Ce qui l’amène souvent à acheter le moins cher, par confusion entre moins cher et moins coûteux, ce qui est parfois une erreur si l’on raisonne sur toute la durée de vie du produit ainsi qu’avec les consommations annexes. Les magazines automobiles font quelquefois ce genre de simulation, et on remarque très souvent que le moins cher n’est pas le moins coûteux. C’est également un élément qui incite à ne pas conserver, on va au moins cher et, du fait d’une durée de vie plus courte, on jette et on rachète. C’est, par ailleurs, très antisocial, car ce sont les personnes les moins fortunées qui sont contraintes d’aller au moins cher. Ce sont donc souvent elles qui paieront plus cher parce que le produit est déceptif en qualité et nécessite d’être renouvelé. Le premier niveau pour avancer vers un nouveau modèle de consommation consiste donc à informer les consommateurs en amont de la transaction, non pas uniquement sur les caractéristiques techniques, mais sur les effets utiles directs, indirects sur l’environnement, immédiats, média, c’est-à-dire dans le temps. Il y a un énorme travail à accomplir. On constate que certaines entreprises s’y engagent d’elles-mêmes, mais il y a peut-être un effort réglementaire à faire, institutionnel, ou d’autorégulation des professions, pour définir quel type d’information, comment les produire, les codifier, les diffuser. À ce moment-là, on réduirait le côté déceptif de la consommation et on pourrait amener les consommateurs à choisir la qualité plutôt que l’apparence de la qualité, ce qui est une des conditions de la conservation.
En aval de la transaction, il est important de garantir les effets utiles, puisqu’on vise la consommation et non plus l’acte d’achat. Je suis toujours étonné qu’on puisse vendre des produits d’équipement durable, comme des téléviseurs, garantis seulement un an. Pourtant, s’ils avaient été conçus sérieusement ils devraient durer au moins cinq ans, donc, pourquoi les garantir un an uniquement ? Par manque de confiance ? Pour prouver qu’ils ont confiance dans leurs produits, les constructeurs devraient les garantir plus longtemps. Ce phénomène est également en train de changer. Kia, le constructeur automobile garantit sept ans sa gamme de voiture, IKEA garantit vingt-cinq ans ses meubles de cuisine (les caissons), mais ils restent des cas isolés. Si on veut vraiment vendre de la valeur d’usage et plus seulement de la valeur d’échange prétexte à écouler du produit, alors on se doit de garantir les effets utiles en qualité et en quantité, c’est-à-dire dans le temps. Je propose donc de faire passer à dix ans la garantie sur tous les biens d’équipements ménagers. On conservera alors bien davantage, car les produits seront conçus différemment. Je ne parle pas de garanties complémentaires, il faut que le fabricant s’engage sur les effets utiles, il concevra donc ses produits totalement différemment. On pourrait objecter qu’un produit conçu pour durer dix ans coûterait plus cher, ce qui poserait un problème d’accès. J’en profite pour noter que coûter plus cher signifie faire le même chiffre d’affaires pour de moindres quantités vendues. En termes de business model cela peut tenir, vendre moins, mais plus cher. Il y a simplement un problème de financement pour les consommateurs. Il faudra donc trouver des systèmes d’ingénierie financière, pourquoi pas par exemple, mettre en location, ou faire payer à l’usage, ou bien mettre en place des sortes de leasing sur de très longues durées, etc. Il faudra faire preuve d’imagination. Il me semble que les organismes de crédits à la consommation qui cherchent une nouvelle légitimité, pourraient réfléchir à une manière de financer le basculement dans une économie des effets utiles.
Un dernier point. Après l’achat, si l’on veut faire durer le produit, il faut aussi le concevoir de manière modulaire. On peut admettre que le progrès technique conduise à une obsolescence du produit, mais la totalité du produit est rarement soumise à l’obsolescence, c’est souvent seulement un module, le cœur technologique, alors que le reste ne l’est pas. Si l’on concevait les produits de manières modulaires, on ne changerait que ce qu’il est vraiment nécessaire de changer. De même pour l’aspect, on pourrait changer la façade et garder le cœur. Voilà pour le produit.
À un deuxième niveau, si l’on bascule vraiment dans le registre de la solution, on n’est plus dans la vente d’effets utiles, mais dans un changement de la relation. On peut montrer au consommateur que l’on a compris que le produit n’est qu’un moyen et que ce qui l’intéresse est de voir ses problèmes résolus. De manière radicale, les entreprises peuvent prendre en charge tous les moyens nécessaires pour résoudre le problème. On vend alors du résultat. L’objet de la transaction se déplace du droit de propriété des produits supposés permettre de résoudre le problème à une transaction sur le résultat lui-même. Dans les formes extrêmes, celui qui fournit la solution reste propriétaire des moyens, il les concevra donc de façon à ce qu’ils durent longtemps. À ce moment-là, lui va conserver. Par exemple, lorsque Free met à disposition chez vous une Freebox, bien sûr que du fait du progrès technique il faut la changer de temps en temps, mais ils ne font pas de pseudo-innovations sur la Freebox, car ils ne veulent pas la renouveler trop souvent sachant qu’elle reste leur propriété. Si vous voulez la changer plus vite, c’est vous qui devez payer. Sinon, on ne la change qu’au rythme requis par le progrès technique, et rien de plus. La Freebox est un moyen de vous offrir la solution d’accès au réseau. Ceci montre bien que le sacro-saint besoin d’être propriétaire des choses, nous verrons ce qu’en dira l’anthropologue, est peut-être exagéré. Personne ne s’est jamais plaint de ne pas être propriétaire de sa box de fournisseur d’accès internet. Vélib’ est un autre exemple : on offre une solution de mobilité à bicyclette sans céder le droit de propriété sur la bicyclette. Et on constate que ces vélos ont été conçus pour durer, plus que ceux vendus chez Décathlon.
Merci de votre attention.